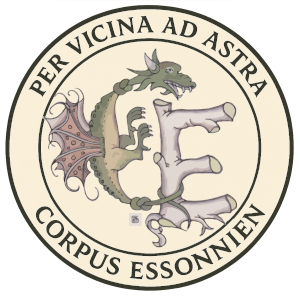hn.e.menault.1859
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
| hn.e.menault.1859 [2023/10/16 22:54] – bg | hn.e.menault.1859 [2023/10/16 22:58] (Version actuelle) – [CHAPITRE IX.] bg | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 496: | Ligne 496: | ||
| * " | * " | ||
| * "Il crut que, par cette raison, il pouvait fort bien demeurer avec lui à tout événement, | * "Il crut que, par cette raison, il pouvait fort bien demeurer avec lui à tout événement, | ||
| - | * Enfin, voici ce que nous lisons dans la //Vie du prince de Condé//, par P***, ouvrage de Pierre Coste, protestant, imprimé en Hollande, et qui parut pour la première fois en 1693: "Le prince de Condé s'en alla de Brie à Chantilly, où il apprit qu'on prenait déjà des mesures contre lui. C'est pourquoi, voyant qu'il n'y pouvait rester sans courir un danger manifeste, il fit savoir au duc d' | + | * Enfin, voici ce que nous lisons dans la //Vie du prince de Condé//, par P..., ouvrage de Pierre Coste, protestant, imprimé en Hollande, et qui parut pour la première fois en 1693: "Le prince de Condé s'en alla de Brie à Chantilly, où il apprit qu'on prenait déjà des mesures contre lui. C'est pourquoi, voyant qu'il n'y pouvait rester sans courir un danger manifeste, il fit savoir au duc d' |
| * "On fut surpris de part et d' | * "On fut surpris de part et d' | ||
| * "Mais un accident imprévu rompit toutes les mesures du duc d' | * "Mais un accident imprévu rompit toutes les mesures du duc d' | ||
| Ligne 529: | Ligne 529: | ||
| * Nous ne savons comment cela se fit, mais [[: | * Nous ne savons comment cela se fit, mais [[: | ||
| * Il y avait dans ce sens des aveux de servage, de vasselage et de bourgeoisie. Les aveux de vasselage portaient le nom spécial de foi et hommage. | * Il y avait dans ce sens des aveux de servage, de vasselage et de bourgeoisie. Les aveux de vasselage portaient le nom spécial de foi et hommage. | ||
| - | * Dans toutes les mutations de fiefs, après la prestation de la foi et de l' | + | * Dans toutes les mutations de fiefs, après la prestation de la foi et de l' |
| * De l'aveu dont nous venons de parler, il résulte que Marc de la Rue rend à monseigneur de Reilhac foi et hommage pour la seigneurie des Morets et pour les dîmes et champarts dé1 la terre et seigneurie des Murs d' | * De l'aveu dont nous venons de parler, il résulte que Marc de la Rue rend à monseigneur de Reilhac foi et hommage pour la seigneurie des Morets et pour les dîmes et champarts dé1 la terre et seigneurie des Murs d' | ||
| * Quelque temps après cet aveu, en 1595, le 9 de septembre, nous voyons une damoiselle Renée de la Rue, veuve de Gabriel de Reviers, escuyer, donner devant Charles Bertrand, notaire royal à Toury, sa procuration pour porter, à M. l' | * Quelque temps après cet aveu, en 1595, le 9 de septembre, nous voyons une damoiselle Renée de la Rue, veuve de Gabriel de Reviers, escuyer, donner devant Charles Bertrand, notaire royal à Toury, sa procuration pour porter, à M. l' | ||
| Ligne 597: | Ligne 597: | ||
| * //Qui a meurtri sa mère et a tué sa sœur,// | * //Qui a meurtri sa mère et a tué sa sœur,// | ||
| * //Qui, comme les Titans, aux astres a fait peur,// |**125**| | * //Qui, comme les Titans, aux astres a fait peur,// |**125**| | ||
| - | * //Et qui a fait manger ses neveux à son frère; | + | * //Et qui a fait manger ses neveux à son frère;// |
| - | * //Qui, son plus grand ami, au temps de sa misère, | + | * //Qui, son plus grand ami, au temps de sa misère,// |
| - | * //A vendu pour argent ou livré par faveur, | + | * //A vendu pour argent ou livré par faveur,// |
| - | * //Qui, cruel, a fiché sa dague dans le cœur | + | * //Qui, cruel, a fiché sa dague dans le cœur// |
| - | * //De son hoste ancien, sans ouïr sa prière, | + | * //De son hoste ancien, sans ouïr sa prière,// |
| - | * //Qui a rompu l' | + | * //Qui a rompu l' |
| - | * //Qui a trahi sa foi, son pays et son roi | + | * //Qui a trahi sa foi, son pays et son roi// |
| - | * //Et allumé les feux d'une guerre civile!... | + | * //Et allumé les feux d'une guerre civile!...// |
| - | * //Quiconque est celui-là, s'il veut que ses péchés | + | * //Quiconque est celui-là, s'il veut que ses péchés// |
| - | * //Ne lui soient à la fin devant Dieu reprochés: | + | * //Ne lui soient à la fin devant Dieu reprochés:// |
| - | * // | + | * // |
| * Peste! comme il y va. Ainsi, selon lui, de son temps, il fallait avoir assassiné père et mère pour manger à [[: | * Peste! comme il y va. Ainsi, selon lui, de son temps, il fallait avoir assassiné père et mère pour manger à [[: | ||
| Ligne 626: | Ligne 626: | ||
| * Laissons-le donc poursuivre tranquillement son voyage, et |**128**| qu'on nous permette de présenter M. le baron de Fœneste. M. le baron, sandis! est un cadet de Gascogne, assez bon diable au fond, mais qui s'est fourré dans la tête qu'en tout, l' | * Laissons-le donc poursuivre tranquillement son voyage, et |**128**| qu'on nous permette de présenter M. le baron de Fœneste. M. le baron, sandis! est un cadet de Gascogne, assez bon diable au fond, mais qui s'est fourré dans la tête qu'en tout, l' | ||
| * "Come à chien maigre bont les mousches, nous troubasmes les poustes tellement rompues par monsur de la Barenne (la Varenne était contrôleur général des postes sous Henri IV) par monsur de la Barenne, qui courait lui-même en personne, que le comte fut contraint de me laisser à Angerbille avec quauque argent pour l' | * "Come à chien maigre bont les mousches, nous troubasmes les poustes tellement rompues par monsur de la Barenne (la Varenne était contrôleur général des postes sous Henri IV) par monsur de la Barenne, qui courait lui-même en personne, que le comte fut contraint de me laisser à Angerbille avec quauque argent pour l' | ||
| - | * Malgré les boutades des poètes, [[: | + | * Malgré les boutades des poètes, [[: |
| * Il est peu de villages, comme on le voit, qui aient été plus divisés qu' | * Il est peu de villages, comme on le voit, qui aient été plus divisés qu' | ||
| * Le calme était donc rétabli, et les seigneurs, hauts justiciers, avaient dans leurs châteaux le libre exercice de leur religion; ils pouvaient admettre trente personnes à leur prêche. Mais bientôt leurs synodes furent de véritables assemblées politiques: ils formèrent un état dans l' | * Le calme était donc rétabli, et les seigneurs, hauts justiciers, avaient dans leurs châteaux le libre exercice de leur religion; ils pouvaient admettre trente personnes à leur prêche. Mais bientôt leurs synodes furent de véritables assemblées politiques: ils formèrent un état dans l' | ||
hn.e.menault.1859.1697493267.txt.gz · Dernière modification : de bg