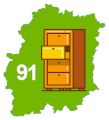Outils pour utilisateurs
Piste:
jeanne.lapastee
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Prochaine révision | Révision précédente | ||
|
jeanne.lapastee [2022/07/23 12:21] bg créée |
jeanne.lapastee [2022/07/23 13:10] (Version actuelle) bg [Bibliographie] |
||
|---|---|---|---|
| Ligne 7: | Ligne 7: | ||
| =====Notule===== | =====Notule===== | ||
| - | * Marguerite des Chênes, religieuse de l' | + | * Jeanne La Pastée, religieuse de l' |
| =====Notice de l' | =====Notice de l' | ||
| - | * **Chapitre XII. Marguerite des Chênes | + | * **Chapitre XII. (...) Jeanne La Pastée (1406-1407) (...).** |
| - | * //Erreurs dans la liste des abbesses. — Ruine de la ferme de Herces. — De nombreux paysans se réfugient à l' | + | * //(...) Éphémère |
| - | * L' | + | * (...). |
| - | * Il est constant pour tous que Pétronille de Mackau mourut en 1394. Mais qui lui succéda? Les Bénédictins nomment Marguerite III, et ensuite Marguerite des Chênes. Appuyés sur |**132** les chiffres inscrits dans le Nécrologe, ils donnent 35 années de pouvoir à ces deux abbesses: 23 ans à la première et 12 ans à la seconde: Or, les documents conservés dans les archives: baux, contrats, procès, transactions, | + | |
| - | * Autre difficulté, | + | |
| - | * Mais comment, dira-t-on, une semblable erreur a-t-elle pu être commise par les savants auteurs du //Gallia//, eux qui avaient sous les yeux l' | + | |
| - | * Marguerite des Chênes, comme toutes les religieuses d' | + | |
| - | * Très apte au maniement des affaires de la communauté, | + | |
| - | * Que devenaient, au milieu de tout ce bruit et de tous ces bouleversements, | + | |
| - | * Puis, nouvelle source d' | + | |
| - | * L' | + | |
| - | * Au milieu de ces contestations, | + | |
| - | * Pendant ce temps les évènements suivaient leur cours. Jeanne de la Rivière, confiée par ses parents à nos moniales, sortait du cloître, et recevait de son père et de sa mère, Marguerite Danneel, la terre et seigneurie d' | + | |
| - | * Au temps de Marguerite des Chênes, l' | + | |
| - | * C'est tout ce que nous avons trouvé, touchant la prélature de Marguerite des Chênes. Elle mourut au mois d' | + | |
| * Une religieuse nommée Jeanne la Pastée, fut choisie pour succéder à Marguerite des Chênes. Le nom de cette nouvelle titulaire n'a été inscrit dans aucun des catalogues donnant la liste des abbesses d' | * Une religieuse nommée Jeanne la Pastée, fut choisie pour succéder à Marguerite des Chênes. Le nom de cette nouvelle titulaire n'a été inscrit dans aucun des catalogues donnant la liste des abbesses d' | ||
| * Pour juger de l' | * Pour juger de l' | ||
| - | * C'est alors que se place la prélature de celle que les Bénédictins ont appelé Marguerite III, et qui doit être nommée Marguerite IV. De ses antécédents, | + | * (...). |
| - | * Sa prélature s' | + | |
| - | * La confusion la plus grande règne alors dans le monastère, |**138** c'est le régime du bon plaisir de chacun. L' | + | |
| - | * Les difficultés d' | + | |
| - | * Les baux sont les seuls actes capables de nous révéler la vie et l' | + | |
| - | * Elles en souffraient de la guerre nos malheureuses moniales, et n' | + | |
| - | * L' | + | |
| - | * Après la mort de leur abbesse, nos moniales élurent l'une d' | + | |
| - | * Une élection eut lieu pour donner une remplaçante à Marguerite V. Les voix se réunirent sur le nom de Marguerite de Montaglant ou Montenglant. Elle appartenait à une famille influente et de plus bienfaitrice de l' | + | |
| =====Documents===== | =====Documents===== | ||
| Ligne 45: | Ligne 25: | ||
| =====Bibliographie===== | =====Bibliographie===== | ||
| - | * [[hn: | + | * [[hn: |
| =====Notes===== | =====Notes===== | ||
jeanne.lapastee.1658571711.txt.gz · Dernière modification: 2022/07/23 12:21 de bg