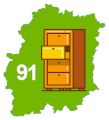Outils pour utilisateurs
Piste:
marguerite.decourtenay
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentes Révision précédente Prochaine révision | Révision précédente | ||
|
marguerite.decourtenay [2022/07/21 02:53] bg |
marguerite.decourtenay [2022/07/21 03:31] (Version actuelle) bg |
||
|---|---|---|---|
| Ligne 11: | Ligne 11: | ||
| =====Notice de l' | =====Notice de l' | ||
| - | * **Chapitre | + | * **Chapitre |
| - | * //La justice. — Abbatiat d’Élisabeth. — Services funèbres, — Donations | + | * //(...) Marguerite de Courtenay. — Sa famille est enterrée à Yerres. — Maladie épidémique. |
| - | d’Aveline Loup et de Pierre de Cossigny. — Marguerite de Courtenay. — Sa famille est enterrée à Yerres. — Maladie épidémique. | + | |
| - | * Les débuts du XIVe siècle furent remplis par la continuation de la lutte engagée pour les droits de justice. En 1301, Pierre de Courtenay, seigneur d’Yerres | + | * (...) |
| - | * Pendant ce temps la succession d’Agnès de Brétigny avait |**100** été recueillie par une religieuse nommée Élisabeth dans les catalogues et Ysabelle dans d’autres documents. De son passé, de sa famille, d’elle-même on ne sait rien. Différents catalogues nous ont appris | + | * Quoi qu'il en soit, l' |
| - | * Son gouvernement fut des plus impersonnels: | + | * À relever maintenant les erreurs des historiographes touchant Marguerite de Courtenay. L'un la fait gouverner l'abbaye à la fin du XIIIe siècle; l'autre lui laisse la crosse en main pendant plus de douze ans; un autre lui attribue un très grand nombre de contrats, tous passés par ses devancières. |
| - | * Ce n’est pas à dire cependant que toute activité eut cessé au monastère durant ces onze ans; loin de là, cette période est riche de petits faits, dignes d’être enregistrés par l’histoire. | + | * Marguerite de Courtenay avait été emportée par une maladie épidémique, |
| - | * Au mois d’avril 1305, une imposante cérémonie eut lieu dans l’église abbatiale. Jeanne de Navarre, femme de Philippe-le-Bel mourut. Comme elle laissait une petite somme à la maison d’Yerres, le roi, qui avait alors de grands démêlés dans son royaume, cherchait à reconquérir les bonnes grâces d’une partie du clergé et des maisons religieuses; | + | * (...). |
| - | * Cette cérémonie funèbre ne fut pas la seule de ce temps-là; elle avait été précédée d’une autre faite pour l’évêque de Paris, Simon Matifas de Bucy, qui avait légué vingt sols tournois de rente annuelle à nos religieuses pour faire chaque année son anniversaire. | + | |
| - | * Dans le même temps, ou peut-être dans les dernières années du XIIIe siècle, l’abbaye eut à recueillir d’assez nombreuses successions. Nous en rapportons deux seulement, tant à cause de la place méritée par les défunts, insignes bienfaiteurs de la maison, qu’à cause des objets laissés par eux au monastère. | + | |
| - | * La première fut celle d’Aveline Loup de Villepinte. On se souvient de ce vieux nom, qui rappelle les plus anciens bienfaiteurs |**101** du monastère; saluons-le une dernière fois, car il ne se rencontrera plus dans nos annales. Aveline Loup, après de longues années passées à l’abbaye, mourut aux environs de 1300 dans un âge avancé. Elle laissa à l’église abbatiale trois statues d’argent doré; l’une de sainte Catherine, l’autre de sainte Marguerite et la troisième de sainte Agnès. De plus elle donna 100 livres pour les réparations à faire dans la chapelle; une rente annuelle de huit sols, pour acheter un cierge et le faire brûler tous les ans, le Samedi Saint, devant le tombeau du Christ; une autre rente pour l’achat des œufs destinés à la nourriture des moniales; deux sous parisis à chacun des chapelains pour la célébration de son anniversaire; | + | |
| - | * Un des contemporains d’Aveline, | + | |
| - | * Pierre de Cossigny, compatriote et peut-être parent d’Agnès de Brétigny, avait parmi les moniales de l’abbaye, deux nièces ou deux sœurs, l’une nommée Jeanne et l’autre Marguerite de Cossigny. | + | |
| - | * À côté de ces opulentes donations nous pourrions en inscrire |**102** d’autres moins importantes, | + | |
| - | * L’abbatiat | + | |
| - | * On doit aussi inscrire à l’actif d’Élisabeth quelques actes d’administration de biens temporels: — en 1302, un bail d’une vigne à Corbeil; — une déclaration de maison à Brie-Comte-Robert; | + | |
| - | * Tels sont les actes concernant l’abbatiat d’Élisabeth. Celle-ci selon toutes les probabilités, | + | |
| - | * Quoi qu’il en soit, l’abbatiat d’Élisabeth à Yerres prit certainement fin dans les derniers jours de l’année 1310, ou bien tout au commencement de l’an 1311; puisque le 1er mars de cette année, Marguerite de Courtenay fut placée à la tête de notre abbaye. La nouvelle titulaire était fille de Jean II de Courtenay, seigneur d’Yerres, et d’Isabelle de Corbeil. Les |**103** discussions au sujet de la justice, entre le monastère et les seigneurs, n’avaient point empêché ceux-ci de confier aux moniales la garde et l’éducation de leurs filles. Marguerite avait été élevée à l’abbaye et y avait passé toute sa vie. Elle était à la fleur de l’âge, lorsqu’elle fut appelée à y porter la crosse. Ce n’était qu’une enfant d’à peine vingt ans; et il est probable que son élection fut le résultat des influences de famille, une sorte de transaction entre les religieuses et le seigneur du lieu. Hélas! malgré sa jeunesse, Marguerite ne gouverna pas longtemps; car elle mourut le 7 juin 1312, après un abbatiat de //quinze mois//, sans qu’il soit resté la moindre trace de son gouvernement. Sa mémoire avait si bien péri dans le souvenir de ses sœurs, que celles-ci, ayant négligé pendant un certain nombre d’années, de tenir leur Obituaire au courant, le nom de Marguerite de Courtenay, fille du seigneur de la paroisse et abbesse de la maison, n’y a pas été inscrit, à moins qu’on ne veuille la reconnaître dans cette // | + | |
| - | * À relever maintenant les erreurs des historiographes touchant Marguerite de Courtenay. L’un la fait gouverner l’abbaye à la fin du XIIIe siècle; l’autre lui laisse la crosse en main pendant plus de douze ans; un autre lui attribue un très grand nombre de contrats, tous passés par ses devancières. | + | |
| - | * Marguerite de Courtenay avait été emportée par une maladie épidémique, | + | |
| - | * Le 9 février 1313, elle nomme des procureurs séculiers pour gérer les affaires temporelles de la communauté, | + | |
| - | * Elle prend également une décision plus importante encore relativement au confesseur de sa maison. Depuis la disparition du prieuré de Saint-Nicolas, | + | |
| - | * La question des confesseurs de religieuses avait attiré l’attention du chef de l’Église dès le moyen âge. On trouve, dans les archives de l’abbaye, une bulle pontificale, | + | |
| - | * L’arrivée de ce moine bénédictin amena une assez notable transformation dans la vie intérieure de nos moniales. Celles-ci, avons-nous dit, étaient alors visitées par un terrible fléau, une épidémie, qui fit parmi elles de nombreuses victimes. Nos moniales, apeurées par la maladie, décimées par la mort, et occupées à soigner leurs agonisantes, | + | |
| - | * À Cluny, paraît-il, la règle bénédictine permettait aux religieux de manger des poulets, des canards, de la volaille, sans enfreindre l’abstinence commandée par la législation monastique. En venant à Yerres, les Clunisiens y apportèrent ces doctrines, et nos moniales, malgré leurs traditions d’austérité, | + | |
| - | * Durant les quarante premières années du XIVe siècle, les religieuses d’Yerres n’écrivirent pas un mot dans leur Obituaire; elles tentèrent bien plus tard de réparer ces lacunes, néanmoins il est impossible de savoir à combien s’éleva le chiffre des morts de cette période, mais il est certain que le nombre de nos moniales, autrefois si considérable, | + | |
| - | * Plusieurs des valides étaient occupées à soigner leurs sœurs malades et infirmes, et cependant il fallait satisfaire à l’obligation de l’office, devenu en peu d’années, | + | |
| - | * Mais ce que l’on conserva avec le plus grand soin ce furent les repas, d’anniversaires. L’usage de ces repas plus copieux, à l’occasion d’un service mortuaire, remontait très loin dans les monastères, | + | |
| - | * Celle-ci laissa également se développer parmi ses sœurs une autre pratique fort dangereuse. On a déjà pu remarquer que le moyen âge n’entendait pas tout à fait, comme les temps modernes, la vie commune, et surtout la pratique du vœu de pauvreté. Les religieuses d’alors, toutes ou presque toutes, sorties de familles aisées, gardaient la propriété et même l’usage de leur fortune sous le contrôle de leur supérieure. Il ne paraît pas que cette manière d’agir ait donné lieu à des abus; mais tout en demeurant maîtresses de leurs biens, les moniales |**107** n’avaient pas le // | + | |
| - | * Elle recueillit la succession de Guillaume Le Nain et d’Aveline, | + | |
| - | * Comme ses deux devancières, | + | |
| =====Documents===== | =====Documents===== | ||
marguerite.decourtenay.1658364813.txt.gz · Dernière modification: 2022/07/21 02:53 de bg