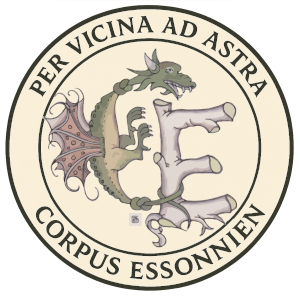marguerite.desguaculs
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
| marguerite.desguaculs [2022/07/24 10:22] – [Notice de l'abbé Alliot] bg | marguerite.desguaculs [2022/07/24 11:54] (Version actuelle) – bg | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 11: | Ligne 11: | ||
| =====Notice de l' | =====Notice de l' | ||
| - | * **Chapitre XIII. Marguerite des Guaculs (1430-1436) | + | * **Chapitre XIII. Marguerite des Guaculs (1430-1436) (...)** |
| - | * // | + | * // |
| - | * L’erreur commise par les Bénédictins, | + | * L'erreur commise par les Bénédictins, |
| - | * Durant toute sa prélature, les Anglais, maîtres de Paris et de toute l’Île-de-France, | + | * Durant toute sa prélature, les Anglais, maîtres de Paris et de toute l'Île-de-France, |
| - | * Dès la fin de juin 1436, une nouvelle abbesse, Huguette de Chacy, a pris la place de Marguerite des Guaculs. Oui lui a mis la crosse en main? Qui l’a investie de sa nouvelle fonction? Il est impossible de le dire. Ce ne fut certainement pas une élection régulière, | + | * (...). |
| - | * Dès qu' | + | |
| - | * Huguette, accompagnée de son fidèle Capel, va de l’un à l’autre, parlemente, raisonne, menace et procède ferme contre ces locataires récalcitrants. Çà et là cependant, elle obtient gain de cause. Ainsi elle arrive à faire un bail régulier de biens situés à Brie, en juin 1436; — elle donne un reçu signé de sa main inhabile, le 23 janvier 1438, à un locataire de bonne volonté. — En 1442, elle loue la ferme de Lieusaint à un écuyer de Corbeil, appelé Simon de Beaucroix ((**Note d' | + | |
| - | * Parmi tous ceux qui s’opposent au prélèvement des droits de l’abbaye, les plus tenaces sont les curés des paroisses, où |**145** naguère l’abbesse était maîtresse de la dîme. Nicole Évot, curé de Servan, est en procès avec Huguette de Chacy, en 1446. Guillaume le Roy, curé, de Lieusaint, fait de même et réclame pour lui 21 setiers de blé. Les deux curés de Brie, celui de Puiselet, et celui de Villabé s’opposent tous à ce que l’abbesse lève la dîme dans leurs paroisses. Les malheureux étaient bien un peu excusables, car ils mouraient de faim, et de plus, les religieuses n’acquittaient plus les charges qui légitimaient la perception de ces redevances ((**Note d' | + | |
| - | * Plus intraitables encore sont les frères en religion de la malheureuse Huguette, les Bénédictins de Saint-Germain-des-Prés et ceux de Saint-Denis. Ces derniers refusent absolument d’acquitter leurs redevances à Villepinte; mais l’abbesse a mis la justice en mouvement, et le 1er décembre 1444, Pierre Poncion, sergent à cheval, se présente à la porte de Jean Souchet, fermier des religieux; il saisit, malgré les protestations de Souchet, 2 muids et 33 setiers de blé, à quoi ont été condamnés les moines envers l’abbaye d’Yerres. Pour des biens situés à Villeneuve-Saint-Georges et à Valenton, les Bénédictins de Saint-Germain des Prés refusent de payer une dette de 42 livres parisis; les deux abbayes procèdent depuis 1440, et en 1447 une lettre est adressée à l’abbesse pour mettre fin au différend. À propos de cette lettre, Fisquet gourmande les auteurs du //Gallia//, leur reprochant d’avoir dit que cette lettre était adressée à Huguette de Chacy, tandis qu’elle ne pouvait l’être qu’à Marguerite des Guaculs. Les Bénédictins avaient vu la pièce, et Fisquet, dont l’autorité n’est pas bien grande il est vrai, s’efforce en vain, de ressusciter une abbesse morte depuis onze ans. | + | |
| - | * Le soin de trouver des fermiers pour des terres abandonnées, | + | |
| - | * Tel fut l’abbatiat tourmenté d’Huguette de Chacy. Un mémoire du XVe siècle | + | |
| - | * La pénurie et la disette étaient le partage de l’abbesse elle-même, et le mémoire déjà cité nous la peint dans l’impossibilité de poursuivre un grand nombre de ses revendications, | + | |
| - | * L’abbaye demeura vacante et comme abandonnée pendant six mois, après le décès d’Huguette de Chacy. Mais à la Toussaint de l' | + | |
| - | * À quelle famille appartenait l’élue de l’évêque de Paris? Il est difficile de le dire, car si les historiographes la nomment //le Camus//, avec l’intention évidente de la rattacher à la grande famille de ce nom, par contre tous les titres du monastère l’appellent invariablement //la Camuse//; et il est probable qu’elle dut son nom à son nez court, large et plat, bien plus qu’à la noblesse de son origine ((**Note d' | + | |
| - | * Quoi qu’il en soit, Guillemette n’arriva pas seule à l’abbaye; avec elle entrèrent sous le cloître deux autres religieuses. L'une appelée Ysabeau de Brindesalle et l’autre Lucienne de Voullac. Elles amenèrent aussi un chapelain pour dire la messe dans la chapelle, et dès lors le monastère reprit une apparence de vie de communauté. |**148** | + | |
| - | * Guillemette et ses compagnes venaient de rentrer à Yerres, lorsqu’un évènement, | + | |
| - | * Les Budé étaient probablement originaires du Hurepoix; ils exerçaient des charges à la cour dès le temps de Charles V. Au mois de septembre 1399, Charles VI, pendant un séjour à l’abbaye de Maubuisson près Pontoise, avait donné des Lettres d’anoblissement à deux frères: Guillaume et Jean Budé. Le premier était officier de bouche de la maison du roi, et le second notaire et secrétaire du prince. Selon toute vraisemblance, | + | |
| - | * L’activité débordante d’Huguette de Chacy avait créé quelques ressources matérielles au couvent, et bien qu’on se plaigne toujours amèrement de la disette, de la pénurie et de l’extrême pauvreté, on vit néanmoins, et qui plus est, on poursuit avec ardeur les revendications entreprises précédemment. | + | |
| - | * Guillaume le Roy, curé de Lieusaint, est le grand adversaire des moniales. Il veut bon gré malgré les empêcher de prélever quoi que ce soit dans sa paroisse, où elles sont |**149** grandes propriétaires. Pour atteindre ce but, il combattra 20 ans, fera faire enquêtes et contre-enquêtes, | + | |
| - | * Des difficultés analogues avaient lieu pour les dîmes de Puiselet, de Tremblay, de Villepinte et d’ailleurs. Il arrive cependant que l’abbesse trouve çà et là des situations moins épineuses. Elle peut louer sans opposition, les dîmes d’Évry, en 1454. A l’aide de son procureur, Henri Brochet, elle passe différents contrats plus ou moins heureux. | + | |
| - | * L’un de ceux-ci lui fut amèrement reproché. On le lui arracha, il est vrai, tout à fait à la fin de sa vie, et peut-être n’en était-elle guère responsable. Un certain Denis Robichon et Jeanne sa femme, venus de Blandy, louaient le 8 janvier 1459, par bail emphytéotique, | + | |
| - | * Trente ans plus tard, quand on attaqua, avec raison croyons-nous, | + | |
| - | * Au milieu des péripéties de son gouvernement, | + | |
| - | * Du petit groupe de religieuses entrées naguère sous le cloître, l’une devint abbesse parmi ses sœurs. Elle se nommait Marguerite d’Orouer, était originaire d’Ozouer-le-Voulgis, | + | |
| - | * Sa prélature à Yerres fut du reste assez éphémère; | + | |
| - | * Marguerite eut à soutenir une des instances de l’interminable procès contre le curé de Lieusaint. Comme l’enquête n’était pas favorable à sa maison, l’abbesse et ses sœurs alléguèrent pour excuse, qu’elles étaient toutes nouvelles venues à l’abbaye, et qu’elles en ignoraient les charges. C’est un des seuls actes de gouvernement, | + | |
| - | * Ce que nous venons de dire suffit pour éclairer les origines, assez mal connues jusqu’ici, | + | |
| Ligne 47: | Ligne 25: | ||
| =====Bibliographie===== | =====Bibliographie===== | ||
| - | * [[hn: | + | * [[hn: |
| =====Notes===== | =====Notes===== | ||
marguerite.desguaculs.1658654543.txt.gz · Dernière modification : de bg