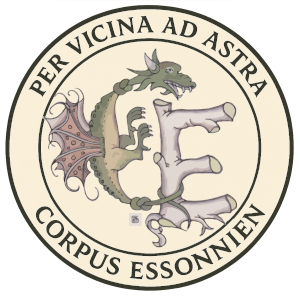catherinecharl.dangennes
Ceci est une ancienne révision du document !
Table des matières
Catherine-Charlotte d'Angennes de Rambouillet (...-1691)
- 41e des 45 abbesses d'Yerres (1670-1691).
- Autres graphies: ?
Notule
- Catherine-Charlotte d'Angennes de Rambouillet, d'abord religieuse de l'abbaye de Pont-aux-Dames au diocèse de Meaux, fut la quarante et unième abbesse de Notre-Dame d'Yerres de 1637 à 1670.
Notice d'Alliot
- Chapitre XXII. Claire-Diane d'Angennes de Rambouillet (1637-1670). — Catherine-Charlotte d'Angennes de Rambouillet (1670-1691).
- Nomination de Claire d'Angennes. — Départ de plusieurs religieuses. — Appel à Rome. — L'évêque de Lisieux. — Sa double visite à l'abbaye. — Règlement qu'il impose. — Les révoltées. — Situation matérielle. — Vente des biens. — Recrutement. — La Fronde. — Séjour à Paris. — Dénuement et pauvreté. — Les chanoines de Paris. — Les objets d'art. — Le Jansénisme, — Henri de Gondrin. — Mort de Claire d'Angennes. — Charlotte lui succède. — Aveu au roi. — Réparation et ornementation de l'abbaye. — Achat de la seigneurie. — Fléchier à l'abbaye. — Dévotion au Saint Sacrement. — Les dernières années. — Les épreuves et la mort. — Œuvre des dames d'Angennes.
- Aussitôt après la mort de Madame des Ursins, on put mesurer la profondeur du désarroi dans lequel elle laissait l'abbaye; et il fallut vraiment méconnaître jusqu'au plus élémentaire respect dû à la vérité, pour oser inscrire sur la pierre, l'éloge dont nous venons de parler.
- Claire-Diane d'Angennes, fille de Charles d'Angennes, marquis de Rambouillet et de Catherine de Vivonne, fut choisie pour porter la crosse à Yerres. Elle était religieuse de l'abbaye de Pont-aux-Dames, au diocèse de Meaux, où elle avait fait profession en 1628 1). |231
- En apprenant cette nomination, douze ou quinze religieuses d'Yerres feignirent de la prendre pour une injure; elles ne pouvaient supporter, disaient-elles, qu'on allât choisir ailleurs que sous leur cloître, une supérieure pour les gouverner, et elles quittèrent l'abbaye afin de ne pas obéir à une étrangère. Dans leur formule de profession, nos Bénédictines promettaient “obéissance et stabilité sous clôture”; en fait, aussitôt professes, elles avaient en horreur aussi bien l'obéissance que la stabilité, car la plupart d'entre elles changèrent au moins trois ou quatre fois de cloître.
- Claire d'Angennes, en entrant à Yerres, y trouva donc un troupeau fort diminué, une douzaine de religieuses au plus, toutes vivant de la vie privée la plus libre et la plus large; l'office divin n'était récité que par deux ou trois jeunes moniales ou novices, car les anciennes, après avoir fait au chœur une courte apparition, regagnaient immédiatement leurs cellules. Le parloir était l'objet d'abus sans nombre; chacune des religieuses y passait tous les jours un temps considérable, et s'y conduisait un peu à sa guise, sans gêne ni contrainte. Il était muni d'une grille, placée là pour le plaisir des yeux et l'édification des étrangers, car une porte, donnant du cloître sur l'antichambre de l'abbesse, permettait aux religieuses d'y pénétrer et d'y converser sans grille; de leur côté les visiteurs, en voyant la porte ouverte, pénétraient librement sous le cloître.
- Aussitôt après avoir reconnu cette situation, Madame de Rambouillet résolut d'y porter remède. Elle s'adressa à ses religieuses, mais celles-ci, lorsqu'elles furent au courant des changements projetés par l'abbesse, se montrèrent en majorité défavorables aux réformes proposées. C'est pourquoi Madame de Rambouillet s'adressa à Rome, puisque d'après la doctrine reçue à Yerres, l'abbaye dépendait immédiatement du Saint-Siège. Rome, condescendant à la demande de Claire d'Angennes, nomma un visiteur spécial. Philippe Cospeau, évêque de Lisieux, fut choisi pour cette mission. Il arriva |232 muni des pouvoirs nécessaires pour faire la visite canonique, rétablir la discipline, ordonner tel changement, et imposer tel règlement qu'il croirait nécessaire et convenable: c'était au mois d'août 1639.
- Le prélat nous a laissé un mémoire détaillé de cette visite. Il raconte gravement la manière dont il prit son rochet, son camail et dont il porta sa crosse… Après ce préambule, nous apprenons qu'il y avait à l'abbaye treize professes, quelques sœurs converses, trois ou quatre novices et deux pensionnaires. Une des converses était en prison pour faute grave, commise dans la maison; mais au lieu de la descendre dans les cachots, qui servaient au XVIe siècle à punir les malfaiteurs justiciables de l'abbesse, on avait enfermé cette malheureuse fille, dans une des chambres hautes du couvent. L'évêque l'interrogea, et il ne dit pas s'il la délivra, mais nous le croyons. Sept des professes acceptaient la visite et les changements projetés; mais six d'entre elles s'opposaient à toute modification dans la règle, et demandaient à ce qu'on les laissât continuer la vie facile qu'elles menaient au monastère. Ces constatations faites, le visiteur regagna Paris et son diocèse.
- Il revint, au commencement de décembre de la même année, accompagné de deux prêtres, dont l'un s'appelait frère Pierre Blandin, religieux dominicain; car il est décidément écrit qu'on ne saurait rendre un peu de vie religieuse à l'abbaye d'Yerres, sans le concours des fils de saint Dominique. Le visiteur fait appeler toutes les religieuses, mais toutes ne répondent pas à son appel. La Mère du Val est malade; les deux sœurs Belle ou Le Belle 2), les mères de Montparlier, de la Borde, le Parcq et Piorot lui font répondre qu'elles jugent sa visite inutile, demandent à n'être pas troublées par le prélat, et ajoutent qu'elles sortiront du cloître, pour aller chercher ailleurs la paix et la tranquillité, qu'on leur refuse désormais à Yerres. |233
- Malgré cette opposition, Philippe Cospeau n'en poursuit pas moins sa mission. Il donne un règlement nouveau, qui n'a rien de bien excessif. Les religieuses jeûneront tous les vendredis de l'année; elles prendront la discipline les vendredis de Carême seulement, et feront maigre quatre jours la semaine: lundi, mercredi, vendredi et samedi. Puis ce sont des prescriptions pratiquées par toutes les âmes pieuses d'aujourd'hui: une demi-heure de méditation le matin, une demi-heure le soir; la communion aux fêtes solennelles, aux fêtes de la sainte Vierge, des Apôtres et des Saints de l'Ordre; récitation de l'office au chœur et en commun, à moins d'une dispense de l'abbesse; suppression de la vie privée et pratique de la pauvreté. Ces deux derniers points ne sont pas imposées aux récalcitrantes. — Règlement concernant le parloir, les malades, les récréations, l'horaire de la journée; nomination d'une dépositaire, d'une tourière et d'une maîtresse des novices.
- Ces mesures prises, le prélat quitta l'abbaye, et son départ fut suivi de celui de plusieurs des insoumises: les sœurs de Montparlier, de la Borde, le Parcq et Piorot.
- C'était beaucoup d'avoir pourvu au spirituel, mais il fallait aussi veiller au temporel. De ce côté encore, Madame de Rambouillet avait hérité d'une situation assez modeste. Pour faire vivre quinze à vingt moniales ou novices, un chapelain et de nombreux domestiques, le revenu ne s'élevait pas au delà de 8 ou 10.000 livres. Il était augmenté, il est vrai, de quelques secours en nature, de maigres pensions, et du revenu de trois ou quatre petites fondations, comme celles que le seigneur de Champcueil payait annuellement à l'abbaye. Il versait trois ou quatre livres seulement, et exigeait un reçu signé de l'abbesse et contresigné du chapelain, pour bien faire constater que celui-ci avait acquitté la fondation 3).
- Tout cela ne constituait pas la prospérité, ne permettait pas même de sortir de la gêne. Aussi Madame de Rambouillet cherchait-elle ailleurs des ressources pour sa maison. Des |234 échanges assez habilement ménagés, comme celui du 21 juillet 1641, avec le sieur Rocquet de Brunoy, lui créèrent quelques ressources. Puis l'abbesse cherche à entrer dans une voie plus moderne, pour alimenter ses finances. Jusqu'ici l'abbaye a vécu presque exclusivement de la location des terres, des dîmes, et n'a pour ainsi dire que des valeurs en biens-fonds. La prélature de Claire d'Angennes marque une transformation dans la fortune du couvent. Nos religieuses commencent à trouver incommodes les propriétés terriennes, sujettes à tant d'accidents, occasionnant tant de procès, nécessitant un personnel si nombreux, si pénible à discipliner; aussi s'efforcent-elles de se débarrasser de leurs terres, afin d'avoir des rentes sur particuliers, et bientôt sur ce que nous appellerions l'État, c'est-à-dire sur le grenier à sel et sur l'Hôtel de Ville. L'esprit des anciennes lois civiles et canoniques était opposé à la vente des biens monastiques, et la législation avait entouré ces ventes d'une multitude d'obstacles difficiles à surmonter. Malgré cela, en 1644, Madame de Rambouillet et six de ses religieuses, passent une procuration à Gabriel le Bourcyer, écuyer, sieur, de Lozière, afin de vendre le fief de Gironville à Théodore de Lannoy, seigneur du lieu. Elles poursuivent également, sans y réussir croyons-nous, la vente à divers particuliers des fiefs de Marencourt, de Souplainville, ainsi que celle des droits de l'abbaye à Étréchy, à Guillerval, à Saint-Cyr-la-Rivière. Plus heureuses en 1646, elles vendent effectivement le fief de Vitri pour 220 livres.
- Le recrutement de l'abbaye est toujours l'objet d'une grande préoccupation. Par suite des départs et de quelques décès, la communauté était fort réduite, vers 1640. Il fallait à tout prix relever le nombre de ses membres. Madame de Rambouillet avait été suivie à l'abbaye par deux de ses sœurs: Catherine-Charlotte d'Angennes et Louise-Elizabeth, qui deviendra abbesse de Saint-Étienne, à Reims. Plusieurs jeunes filles, prises dans de bonnes familles, connues de Madame de Rambouillet, entrèrent également au cloître. Parmi elles on trouve les sœurs Chauvelin, les sœurs d'Espinay, Clémence de Riberolles, Catherine Sallantin. Cette |235 dernière sortait de la Cour, où elle était attachée à la belle Julie d'Angennes, sœur de l'abbesse. Enfin, on fit appel même à des moniales d'autres monastères, comme il arriva pour Marie Bourcyer qui vint, munie de ses bulles, de l'abbaye de Bussières à Bourges, et fut affiliée au couvent d'Yerres.
- Tout marchait à souhait dans la communauté reconstituée par les soins de Claire d'Angennes. Catherine Board était prieure, Élisabeth Clausse, Anne de Marie, Charlotte Board, Françoise Augelin et Anne Trousseau étaient mères discrètes et remplissaient différentes charges; le noviciat se repeuplait peu à peu; les ressources sans être abondantes étaient régulières avec une tendance à s'élever; les baux étaient renouvelés avec exactitude 4). On entrait réellement dans une ère de prospérité, lorsqu'une nouvelle épreuve vint fondre sur la maison.
- Les guerres de la Fronde qu'on a si souvent raillées, et auxquelles on n'accorde généralement pas une grande importance, eurent cependant des conséquences terribles, surtout dans les environs de Paris. Notre abbaye en souffrit particulièrement. Dès 1650, des troupes, répandues dans la vallée de l'Yerres, avaient inquiété nos moniales, au point de leur faire suspendre pour un temps leurs exercices de communauté. Bientôt les familles effrayées rappelèrent les jeunes pensionnaires confiées au cloître, que de leur côté, les religieuses ne tenaient pas à garder, par crainte du danger. L'année 1651 se passa en alertes continuelles; mais au commencement de 1652, l'orage éclata et faillit submerger l'abbaye. Le duc Charles de Lorraine vint s'établir, avec son armée, à Villeneuve-Saint-Georges; ses soldats bivouaquaient dans les environs, et sous prétexte de faire des fourrages, rançonnaient les paisibles habitants; l'abbaye d'Yerres était là à portée de leur main, elle ne fut pas épargnée et subit le sort commun. Ce n'était rien encore cependant. Au mois de juin, |236 Turenne lève le siège d'Étampes, observe, des hauteurs de Villeneuve-sur-Auvers, l'armée des Princes, pendant quatre ou cinq jours; puis il marche droit sur Corbeil, où il passe la Seine le 14 juin, ensuite l'Yerres à Brunoy, et traverse le Révillon, en longeant les murs de l'abbaye, où il laisse un fort détachement, et va se poster à Grosbois. À l'arrivée des soldats, nos moniales épouvantées fuient dans toutes les directions; les unes rentrent dans leurs familles, les autres se sauvent à Paris avec l'abbesse, pour chercher un refuge dans leur maison de la rue des Nonnains-d'Yerres. Le monastère, occupé par la troupe, est laissé à la garde des domestiques et d'une ou deux vieilles religieuses, moins timides et moins apeurées que les autres. Toute vie monastique y est suspendue, et durant huit ou dix mois, Madame de Rambouillet erre dans la capitale d'une maison à l'autre, réduite aux expédients pour faire vivre son petit troupeau, menacée tantôt par l'épicier 5), tantôt par le boulanger, de se voir suspendre les fournitures, faute de paiement; elle fait des billets à celui-ci et à celui-là, mais à chaque échéance, elle est obligée de solliciter un sursis.
- Rentrée à l'abbaye en mars ou avril 1653, Glaire d'Angennes n'y trouve que des ruines: portes, fenêtres, clôtures, tout est endommagé, il faut une armée d'ouvriers pour remettre les choses en état. Au dehors, la situation n'est pas moins lamentable, la campagne est ruinée. Au cours de l'année 1654, l'abbesse ne passe pas moins de vingt baux, pour donner les biens de son couvent à des particuliers, qui se chargent de remettre les fermes et les maisons en valeur, sans payer aucune redevance au monastère, malgré le pressant besoin qu'il en a. Tous ces contrats parlent de ruines amassées par les maux de la guerre, de campagnes dévastées, de champs en friche, de fermes détruites et d'habitations brûlées et abattues.
- Pendant qu'elle surveillait les réparations. Madame de Rambouillet apprit la nomination de sa sœur Louise d'Angennes, |237 à la coadjutorerie de l'abbaye de Saint-Étienne à Reims, où elle était demandée par l'abbesse, Madame de Villiers-Saint-Paul. Elle voulut l'y conduire elle-même, et toutes deux partirent pour Reims, au mois de mai 1654.
- À son retour à Paris, l'abbesse d'Yerres dut y séjourner pour traiter une affaire assez délicate. Le premier archevêque de Paris mourut en 1654. Depuis l'arrangement conclu par Madame de Luxembourg, nos moniales n'avaient plus la chèvecerie; mais ce droit n'avait pas été cédé purement et simplement, il avait été transformé. Quand Madame de Rambouillet réclama les droits de sa maison, les bons chanoines de la métropole répondirent par une fin de non-recevoir d'abord; et devant les instances de Claire d'Angennes ils lui dirent que c'était là “pures bagatelles, rêves de femmes et insanités”. Comme à Yerres on ne voulait pas céder, cette discussion dura sept ans, et ce ne fut pas la dernière avec le Chapitre de Paris.
- Rentrée à Yerres, Madame de Rambouillet s'y appliqua au gouvernement de sa communauté, avec une préoccupation de l'observance, qui lui faisait parfois oublier l'esprit de l'Évangile; car tandis qu'elle insistait pour obéir aux différentes prescriptions de la règle, elle-même manquait gravement à la pauvreté et à la stabilité dont elle avait fait vœu. Comme Madame des Ursins, elle acheta en Italie des marbres précieux; elle remplit l'abbaye de tapisseries de haute lice et d'autres objets d'art mondain, peu en rapport avec la situation précaire de sa maison, et surtout en opposition complète avec la pauvreté monastique ou simplement évangélique.
- Chose plus grave encore, dans ses courses à travers le monde, et dans de trop fréquentes visites à l'Hôtel de Rambouillet, à Paris, au milieu de toutes les Précieuses, Claire d'Angennes s'était laissée séduire par les idées Jansénistes. Quelques-unes de ses filles en avaient également rapporté des germes, puisés à différentes sources durant les évènements de 1652 et 1653, pendant le temps qu'elles avaient vécu en dehors de l'abbaye. Tout cela avait fermenté entre les murs du cloître, et commençait à se répandre au dehors. Le nouvel archevêque de Paris, Hardouin de Péréfixe, de qui |238 nos religieuses se disaient toujours exemptes et indépendantes, en fut informé. Il pressa l'exécution d'un bref du pape Alexandre VII, donné dès 1660, à Claude Blancpignon, et lui ordonna d'informer contre les doctrines religieuses des Bénédictines. Nous ne savons point le résultat de cette enquête, car les pièces en ont été détruites, mais il est permis de croire que Madame de Rambouillet et ses filles ne se montrèrent pas opiniâtres, et que l'affaire en resta là.
- L'abbesse d'ailleurs prenait de sages mesures pour conserver la paix autour d'elle. Afin de diminuer le personnel domestique de l'abbaye, elle loua la ferme du couvent à un tenancier, nommé Sadier, et l'isola complètement des bâtiments claustraux. Comme dame justicière de son domaine, elle tient encore à la nomination d'un prévôt, mais Gabriel Moreau, choisi en 1664, sera d'humeur pacifique, et ne remplira pas les anciens cachots de malheureux, coupables d'avoir manqué de respect à la propriété abbatiale; il prononcera seulement quelques amendes légères; il n'a à son actif ni incarcération, ni surtout aucun châtiment corporel.
- Au mois de septembre 1661, l'abbaye reçut la visite de l'Illustrissime et Révérendissime seigneur, Messire Louis-Henri de Gondrin, archevêque de Sens. Ce prélat n'était appelé à Yerres par aucune enquête, ni information. Sa visite était de simple courtoisie. Il sollicitait tout simplement de Madame l'abbesse et du couvent “l'achat” de quelques pieds de terre à Paris, “pour la commodité et augmentation de son Hostel archiépiscopal”, situé rue du Figuier et joignant “l'Hostel d'Hyère, assis rue des Nonaindières.” Les moniales reçurent l'archevêque avec empressement, firent droit à sa demande, lui vendirent le terrain demandé et en passèrent le contrat, séance tenante, “ès présence de Louis Quoniam, prêtre chapelain de l'abbaye, et Illustre et Révérente dame Clari-Diane d'Angennes, d'Anne de Marie prieure, et de Gabrielle Passavant célerière et portière.” Monseigneur de Gondrin, satisfait de Madame de Rambouillet et de ses filles, quitta l'abbaye, après avoir procuré à la communauté une journée de fête agréable à tous.
- Claire d'Angennes, nous l'avons déjà dit, s'employa avec |239 zèle au recrutement de sa maison, mais elle ne réussit pas à lui rendre son ancienne splendeur, et ne put jamais en faire une grande maison. Entre 1660 et 1670, le nombre de ses sœurs ne dépassa jamais le chiffre de vingt ou vingt-deux professes de chœur. Cette pénurie de vocations fut une de ses tristesses, surtout à la fin de sa vie, qui se termina le 9 mars 1670, après un abbatiat de 33 ans.
- Depuis 1665, Madame de Rambouillet, d'une santé affaiblie et languissante, ne demeura guère dans son monastère. Elle passa la majeure partie de son temps dans sa famille à Paris, où elle mourut très probablement, car la date de son décès n'a été inscrite dans aucun des papiers du couvent. C'est le Père Anselme qui la donne, et on ne s'explique pas que les auteurs du Gallia l'aient fixée au 19 mars 1669, puisqu'ils n'invoquent pas d'autre autorité que celle de l'Histoire des Grands Officiers de la Couronne, qui les contredit.
- Charlotte-Catherine d'Angennes succéda à sa sœur et continua son gouvernement. C'était une femme grave sous tous les rapports. Elle était âgée de 47 ans, et comptait plus de trente années de vie religieuse, ayant fait profession à 16 ans. Cette maturité ne l'empêcha pas de se livrer aux entreprises les plus hasardeuses et les plus critiquables.
- Aussitôt après sa prise de possession, elle fit au roi une déclaration des biens de sa communauté. Comme les précédents, cet aveu est assurément incomplet: il enfle les charges et amoindrit les recettes; tel quel, il permet néanmoins de voir que la prospérité rentrait peu à peu au monastère depuis les évènements de 1653 6).
- Charlotte d'Angennes mit également la dernière main a des |240 travaux entrepris sous l'administration de sa sœur. Les bâtiments conventuels, édifiés cent cinquante ans auparavant par Madame d'Estouteville, avaient subi bien des assauts depuis lors, et les remaniements, opérés par Mesdames de Luxembourg et des Ursins, les avaient plutôt ébranlés que consolidés.
- D'importantes réparations y furent faites par les Dames de Rambouillet. Charlotte s'occupa spécialement de la chapelle dont elle fit disparaître les dégradations. Le portail en fut profondément modifié. Sur une façade renaissance elle placarda des ornements du style de Louis XIV, au milieu desquels se lisait la date de 1670. Puis comme elle avait sur les royales origines de l'abbaye les mêmes idées que ses devancières, elle fit graver de chaque côté de la statue de la Sainte Vierge, placée au-dessus de la porte d'entrée, deux écussons: l'un de France, surmonté de la couronne royale; l'autre ne fut historié que plus tard; enfin dans le portail même, l'écusson des Rambouillet, sommé d'une couronne de marquis, dans laquelle passait une crosse d'abbesse. À l'entrée principale du monastère, une inscription apprenait aux passants que l'abbaye avait été fondée par Louis le Gros en personne, pour des religieuses Bénédictines 7). Comme on le voit, grâce aux singulières recherches de du SaussaY, consignées dans une lettre à Charlotte d'Angennes, et datée de Toul, on avait marché depuis le temps de Madame des Ursins. Pour mettre tous les signes extérieurs d'accord avec l'enseignement reçu, on brisa l'ancien sceau de l'abbaye, devenu trop simple. Depuis l'origine les armes étaient d'azur, à la Vierge mère couronnée et portant l'enfant Jésus; au contre scel, un écu rond, chargé d'une crosse d'abbesse accostée de deux fleurs de lys. Les nouvelles armes furent de France et de Navarre, accolées à l'écusson de la titulaire en charge; et bientôt |243 toutes les pièces manuscrites furent timbrées de ce pompeux écusson, à la manière moderne.
- Pendant que ces travaux d'ornementation s'exécutaient, Charlotte d'Angennes sollicita, du nouvel archevêque de Paris, dont elle se disait indépendante, la permission de sortir de son cloître, pour traiter plus aisément dés affaires de sa communauté. Monseigneur de Harlay n'était pas très sévère sur la clôture; la permission fut accordée, et voilà notre abbesse, accompagnée de Catherine Salantin et d'une autre moniale, à Paris pour plusieurs mois.
- Quelles étaient donc les affaires si importantes, qui nécessitaient la présence à Paris de Madame l'abbesse et de ses deux compagnes? Pour l'entendre, il faut reprendre les choses d'un peu plus haut.
- En 1638, Charles de Valois, duc d'Angoulême, avait érigé à Yerres un nouveau fief, la Grange du Milieu, en faveur de Duret de Chevry. A la même époque, la seigneurie d'Yerres, morcelée entre les nombreux héritiers Budé, s'était reconstituée en une seule main, et appartenait en 1669 au sieur Burin, écuyer. Ce gentilhomme fit de mauvaises affaires; la terre fut saisie entre ses mains, mise à l'encan et achetée par M. de la Briffe, qui pouvait bien n'être qu'un prête-nom. Car, en voyant la seigneurie aux enchères, une idée grandiose avait germé dans la tête des deux dames de Rambouillet; elles avaient rêvé de devenir dames d'Yerres, sous le double rapport spirituel et temporel, et d'accrocher à leur crosse abbatiale, trop simple à leurs yeux, la couronne territoriale de l'antique seigneurie d'Eustachie de Corbeil, des du Donjon, des Courtenay et des Budé.
- Nous ne savons par quel artifice légal, le domaine d'Yerres, acquis d'abord par le M. de la Briffe, fut vendu de nouveau, et acheté, par sous-seing privé, au mois d'octobre 1671, par Charlotte d'Angennes et ses deux compagnes, de compte à demi avec un sieur Bizet de la Barroire, pour l'énorme somme de 120.000 livres.
- Voilà Charlotte d'Angennes qui, réalisant une des folles pensées de sa sœur Claire, est devenue dame temporelle d'Yerres. Il s'agit maintenant de régulariser cette situation. |244 Le marché est approuvé, le 13 août 1672, par Guillaume de Lestocq, docteur en théologie de la maison de Sorbonne, visiteur et supérieur de l'abbaye d'Yerres. Les moniales, au nombre de vingt-trois professes, réunies sous la présidence d'Anne de Marie, leur doyenne, ratifient aussi le marché et donnent, procuration à l'abbesse, toujours à Paris, pour passer le contrat.
- À cette occasion, on dressa un mémoire explicatif et justificatif de cette coupable acquisition. Il y est dit que les revenus du domaine sont considérables et faciles à recueillir; que par cet achat, on évite un coûteux procès avec les habitants de Brunoy, au sujet d'un chemin, et d'autres procès toujours renaissants avec divers particuliers, à Yerres et à Montgeron.
- Ce n'était pas tout d'acheter la seigneurie et de devenir la dame d'Yerres. Il fallait payer, et ce fut là que les difficultés commencèrent. Charlotte d'Angennes dut recourir aux emprunts onéreux et aux ventes du domaine. Ses premières opérations portèrent sur la maison de Paris. Elle fut vendue 24.000 livres aux Religieux de Sainte-Croix-de-la-Bretonnerie, parce que, dit le mémoire destiné à justifier cette vente, le prix était convenable et avantageux, et que d'ailleurs cette maison était humide, fréquemment envahie par l'eau, demandait beaucoup de réparations. Avec l'ancienne législation, quand on vendait un fief, on se dessaisissait bien rarement de tout le domaine; il restait toujours quantité de droits féodaux, dont le vendeur gardait la jouissance. Ce fut ce qui arriva dans cette circonstance, et par la suite de nombreux procès naquirent de ce contrat, entre l'abbaye et les acquéreurs.
- Madame de Rambouillet emprunta, pour payer ses acquisitions, des sommes assez rondes aux Religieuses de la Visitation, aux Sœurs Augustines de Chaillot, à d'autres communautés et à divers particuliers. Tous ces prêteurs revendiqueront plus tard, avec âpreté, leur argent, qu'ils auront peine à recouvrer. En attendant c'est l'époque des procurations, des contrats signés à la grille de l'abbaye par toutes les moniales, présidées par leur prieure Lucrèce du Raiz, qui régit la |245 communauté pendant les absences prolongées de l'abbesse. De 1671 à 1674 on ne passa pas moins de quarante ou cinquante de ces actes: ventes, achats, échanges, transactions avec les sieurs de la Barroire, de la Briffe, et M. le Camus, maintenant propriétaire et seigneur de la Grange: le tout à la plus grande joie des notaires sans cesse sur la route de l'abbaye, avec leurs minutes et leurs grosses. Au milieu de leurs grimoires, ces tabellions nous apprennent que Charlotte d'Angennes résidait le plus souvent à Paris, tantôt chez les Religieuses du Calvaire, rue Neuve-Saint-Louis; tantôt à l'Hôtel de Rambouillet, rue Saint-Thomas-du-Louvre, où elle s'établit presque à demeure, pendant la majeure partie des années 1673 et 1674; que durant ce temps, la prieure maintenait une stricte régularité au monastère, où il y avait jusqu'à vingt-cinq et vingt-six professes; et que l'abbaye avait deux prêtres: Jean Ollivier, confesseur des moniales, et Claude Jamet, leur chapelain.
- De temps à autre. Madame de Rambouillet se dérobait à ses occupations de Paris, pour venir à l'abbaye. Le 2 janvier 1672, elle présida, avec sa sœur, l'abbesse de Saint-Étienne à Reims, une cérémonie religieuse, dans laquelle Fléçhier prononça l'oraison funèbre de Julie d'Angennes, duchesse de Montausier, leur sœur; ce qui attira à Yerres un grand concours de gens du monde, et de la plus haute société.
- Les affaires d'ordre temporel réclamaient aussi parfois la présence de l'abbesse. Au mois d'octobre 1674, elle loua, pour la somme de 4.000 livres, sa nouvelle acquisition du château d'Yerres à Florent Boursault, son procureur. On fit à cette occasion une description minutieuse et détaillée de tous les appartements de la demeure seigneuriale, qui était pourvue d'une chapelle particulière 8). Charlotte d'Angennes se réserva soigneusement les droits de justice, haute, moyenne et basse, et nomma un prévôt et des sergents pour les exercer. Elle vendit un peu plus tard une petite portion de bois à Pierre Demorange, secrétaire de l'archevêque de Paris, et |246 possesseur d'une maison de campagne, située entre l'abbaye et les Camaldules.
- Au milieu de ses préoccupations temporelles, l'abbesse n'oubliait pas le coté spirituel de sa charge, car malgré sa vie agitée, elle était très pieuse. Pour favoriser et développer la dévotion de ses tilles, elle sollicita et obtint plusieurs concessions d'indulgences, la permission de donner un grand nombre de saluts du Saint-Sacrement dans l'église du couvent, alors que la chose n'était pas aussi fréquente qu'aujourd'hui.
- Elle fut une véritable apôtre de cette dévotion au Saint-Sacrement. Au cours de ses pérégrinations à Paris, elle se lia d'amitié avec Anne de Lorraine, abbesse de Montmartre, toute enflammée de zèle pour Jésus-Christ, dans le sacrement de l'autel. Charlotte d'Angennes, désireuse de faire mieux connaître cette nouvelle forme du culte à ses filles, demanda à l'abbesse de Montmartre une de ses religieuses, pour l'aider à établir cette dévotion à Yerres. “Illustre princesse, Anne de Lorraine lui donna la Mère Anne Mauchon, qui sortit de Montmartre, vint dans notre abbaye et y remplit la charge de prieure 9), pour travailler plus efficacement à la propagation de la dévotion, chère au cœur des deux abbesses.”
- La nouvelle prieure n'était pas venue les mains vides, son abbesse lui avait donné pour son nouveau monastère, une statue de la Sainte Vierge tenant l'enfant Jésus, de deux pieds de haut. Cette œuvre d'art fut placée au côté droit de la grille du chœur, et chaque mois, la communauté récita un Sub tuum, à l'intention de la donatrice. Après le décès de la Mère Mauchon, le couvent chanta un De profundis au jour anniversaire de sa mort.
- À Paris, l'abbesse d'Yerres s'était également liée d'amitié avec Marthe Davy, veuve du marquis de Ferrière, qui donna “à vertueuse dame Charlotte d'Angennes” une cassolette en argent, pour servir devant le Saint-Sacrement. Au décès de cette nouvelle bienfaitrice, le couvent dut faire acquitter autant de messes qu'elle avait passé d'années sur la terre; c'est pourquoi elle ajoute qu'elle est née en 1621. |247
- Parmi les fervents de la dévotion au Saint-Sacrement, attirés à Yerres, notons des prêtres en assez grand nombre: Guillaume Toustain, successeur de Pierre Rabure comme confesseur des moniales, Louis de la Villette, Claude Macé 10) et quelques autres.
- Toutefois la piété de Madame de Rambouillet ne lui faisait point abandonner ses hautes visées seigneuriales. Il paraît que lors de la première acquisition du domaine d'Yerres, elle n'avait que les deux tiers de la seigneurie, une nouvelle adjudication lui donna l'autre tiers, ainsi que des terres en roture, en sorte que toute cette belle opération lui revint à 209.000 livres. Davantage encore, le fief créé en 1638, à la Grange, l'offusquait; elle voulait être seule et unique dame d'Yerres, sans partage. Elle tenta d'acheter le château pour le démolir; et déjà une expertise des matériaux et de quelques terres indépendantes avait été fixée au prix de 45.000 livres. Heureusement elle ne put mettre à exécution cette dernière folie, et M. le Camus demeura propriétaire et seigneur de la Grange du Milieu.
- Un homme néfaste servait à Charlotte d'Angennes de conseil secret dans toutes ces entreprises; il s'appelait Alexandre Dumas, était chirurgien de l'abbaye aux gages annuels de 100 livres, et louait en outre la portion des dîmes paroissiales d'Yerres, pour 130 livres.
- Éprise de sa haute dignité, Madame de Rambouillet voulait être exempte de la juridiction épiscopale. En 1682, Louis XIV nomma, on ne sait pourquoi, l'archevêque de Paris visiteur de l'abbaye. François de Harlay vint donc au monastère pour accomplir sa mission; l'abbesse le reçoit, ne pouvant décemment lui fermer sa porte; mais elle requiert un notaire et fait dresser un procès-verbal de protestation, contre ce qu'elle nomme la violation des droits de sa maison, immédiatement soumise au Saint-Siège. Cette protestation fut peut-être couronnée de succès puisque l'année suivante, 1683, nous trouvons pour visiteur le Père Claude de Sainte-Marthe, de l'Oratoire, nommé par le Pape, |248 et agréé par le roi; car, dit une note des archives, il fallait au visiteur “des Lettres d'attache” du prince, à cause du temporel de l'abbaye.
- Les dernières années de Charlotte d'Angennes furent employées par elle à se débattre contre ses créanciers, qui devenaient chaque jour plus pressants et plus nombreux. La grande dame était aux prises avec les financiers et les hommes d'affaires. Malgré sa fierté naturelle, elle en était souvent réduite aux pires expédients; ce qui usait ses forces et sa santé, la poussait à fuir l'abbaye, pour aller à Paris chercher un refuge auprès des siens, où elle s'efforçait d'oublier ses chagrins domestiques, chaque jour grandissants. L'année 1690 lui fut particulièrement douloureuse. La mort lui enleva quatre de ses sœurs les plus dévouées: Gabrielle Passavant, Catherine Salantin, sa fidèle compagne, Jeanne Legendre et Clémence de Riberolles.
- Ces épreuves achevèrent de la briser; elle mourut le 20 mai 1691 après cinquante-trois ans de vie religieuse, et un abbatiat de vingt-un ans accomplis. Son décès n'a pas été inscrit dans les registres de l'abbaye, ce qui fait supposer, qu'elle ne mourut pas au couvent. Comme sa sœur, elle s'était accoutumée à s'en aller fréquemment à Paris, dans différentes communautés, et surtout à la demeure de ses parents, où elle avait un quasi domicile, et où elle rendit vraisemblablement le dernier soupir.
- L'œuvre des deux dames de Rambouillet à l'abbaye est fort discutable. Toutes deux étaient pieuses et ferventes, c'est incontestable: les exercices de piété, les concessions de reliques et d'indulgences, sollicitées par elles, les associations de prière, la dévotion au Saint-Sacrement sont là pour témoigner de leur zèle et de leur dévotion. Cependant même à ce point de vue si louable de la piété, elles furent indiscrètes; car elles multiplièrent outre mesure les offices, les exercices et les pratiques de dévotion, à tel point qu'on ne les pouvait plus porter, et que bientôt il faudra les réduire. — Quant à leurs entreprises dans l'ordre temporel, elles furent blâmables et condamnables sous tous les rapports. L'achat de la seigneurie fut une faute impardonnable. Il est bien évident |249 qu'à ces filles de grands seigneurs, l'humble crosse des filles de Saint-Benoît ne suffisait pas; le sang aristocratique qui coulait dans leurs veines les poussait, malgré l'humilité des formules employées de temps en temps, à paraître et à être de grandes dames selon le monde. Orgueilleuses et vaniteuses toutes les deux, elles ne comprirent rien à la stabilité monastique, firent litière de la loi de la résidence, passèrent une notable partie de leur temps, sur les routes ou à Paris, sans nécessité suffisante. Pour elles, il fallait être et paraître.
Documents
Sources
Bibliographie
- Jean-Marie Alliot, “Chapitre XIX. Marie de Pisseleu (1544-1553)”, in Histoire de l'abbaye et des religieuses bénédictines de Notre-Dame d'Yerres au diocèse actuel de Versailles, par l'abbé J.-M. Alliot, curé de Bièvres (in-8°, XVI+313 p.), Paris, Alphonse Picard, 1899, pp. 230-249, spéc. pp. .
Notes
Documents
Sources
Bibliographie
- Jean-Marie Alliot, “Chapitre XXII. Claire-Diane d'Angennes de Rambouillet (1637-1670). — Catherine-Charlotte d'Angennes de Rambouillet (1670-1691)”, in Histoire de l'abbaye et des religieuses bénédictines de Notre-Dame d'Yerres au diocèse actuel de Versailles, par l'abbé J.-M. Alliot, curé de Bièvres (in-8°, XVI+313 p.), Paris, Alphonse Picard, 1899, pp. 231-249, spéc. pp. 231-.
Notes
1)
Note d'Alliot — Au début de l'abbatiat de Madame d'Angennes, en 1640, une nouvelle maison religieuse vint se fonder aux portes de l'abbaye. Les Camaldules, religieux d'origine italienne, s'établirent à Grosbois. sur la paroisse d'Yerres. Les nouveaux venus et nos Bénédictines vécurent côte à côte, sans que les rapports entre les deux maisons fussent jamais empreints d'une hostilité ouverte, |231 mais aussi sans avoir l'une pour l'autre une sympathie bien marquée. — Il ne faut pas confondre les Camaldules de Grosbois, avec le château de Grosbois, situé non loin d'Yerres, mais sur la paroisse de Boissy-Saint-Léger.
2)
Note d'Alliot — Celles-ci se ravisèrent sans doute, car, en 1645, Catherine Belle est encore à l'abbaye: elle y reçoit des Lettres royaux pour se faire mettre en possession du prieuré de Chambly, au diocèse de Beauvais, vacant par la mort de sœur Françoise Cousin, religieuse de Saint-Remy de Senlis. Catherine ne réussit probablement pas, puisqu'elle mourut à Yerres en 1664.
3)
Note d'Alliot — En 1637, c'est un nommé Glasson qui est chapelain; il est bientôt remplacé par le prêtre Jean Troa, auquel succède J. -B. le Gras.
4)
Note d'Alliot — Claire d'Angennes loua le moulin de Masières, le 7 août 1538, à Philippe Coqueret, pour 400 livres. — Le 2 juillet 1643, à Pierre Bezançon, pour 540 livres. (Pierre avait épousé Jeanne Boireau, veuve de Philippe Coqueret). — Le 25 août 1657, à Louis Périer pour 400 livres. — Le 8 juin 1661, à Marc Andelet, pour 600 livres.
5)
Note d'Alliot — Au mois de janvier 1653, Claire d'Angennes avait fait au sieur Bruand, épicier, rue Saint-Anthoine, à Paris, un billet de 600 livres, payable à Pâques, elle ne put l'acquitter qu'au mois d'août suivant.
6)
Note d'Alliot — Cet aveu déclare que l'abbaye possède 12 fermes, louées ensemble 7.775 livres, plus 12 ou 15 muids de grain. (Il n'y est pas question du bail emphytéotique de Sénart, par exemple, ni des redevances, comme les dîmes, les lods et ventes, les droits de justice, les aumônes, les pensions.) —— Avec le revenu, il faut faire vivre 37 religieuses, professes, novices et converses: 2 ecclésiastiques, un jardinier, un garçon, un valet, une servante et quelques autres domestiques, soit un total de 12.600 livres de dépenses. — Les ecclésiastiques ont chacun 300 livres; le jardinier 100 livres; les autres domestiques ensemble 720 livres; le médecin 300 livres; le chirurgien 100 livres; un homme d'affaires 400 livres; les avocats et procureurs 500 livres; les charges d'entretien 2.000 livres.
7)
Note d'Alliot — Voici cette inscription: Veüe de l'abbaye de / Nostre-Dame d'Yerre / fondée par Louis le Gros, / roy de France, pour des / religieuses bénédictines / l'an 1120. En Brie, à 5 lieues de Paris.
8)
Note d'Alliot — Cette chapelle n'est pas mentionnée dans le Pouillé du diocèse de Versailles, de M. l'abbé Gautier.
9)
Note d'Alliot — Ce titre, donné à Anne Mauchon, n'empêcha pas Lucrèce du Raiz de garder et d'exercer la charge de prieure de la communauté.
10)
Note d'Alliot — Celui-ci eut bientôt des procès avec l'abbaye, au sujet des dîmes de Carbouville, dont il était fermier.
catherinecharl.dangennes.1658807392.txt.gz · Dernière modification : de bg