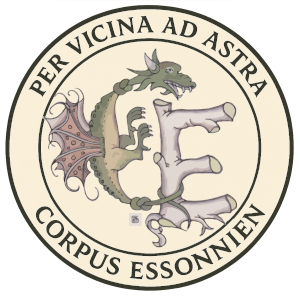hn:ch.ferdinanddreyfus
Table des matières
Charles Ferdinand-Dreyfus (1888-1942)
- Maire de Fontenay-lès-Briis (…1924-1931…)
- Directeur Fondateur et historien de l'école d'agriculture de Bel-Air à Fontenay-lès-Briis.
Famille
- Charles Ferdinand-Dreyfus, né Charles Dreyfus à Paris 16e arrondissement le 14 janvier 1888, était le fils de Ferdinand-Camille Dreyfus (dont le patronyme fut modifié en Ferdinand-Dreyfus par décret du président de la République en date du 14 mars 1896), et d'Adèle Porgès (1860-1917).
- Il avait pour frère:
- Jacques Ferdinand-Dreyfus (1884-1943), marié avec Amélie Mayer (1888-1969)
- Il se maria à Paris 17e arrondissement le 6 juillet 1910 avec Germaine-Edwige-Anna Behrendt (1892-1972) fille de Max Behrendt (1858-1937) et d'Ève-Cécile Kapferer (1892-1956), dont il divorça le 18 janvier 1919.
- De cette union naquirent:
- Denise Ferdinand-Dreyfus (v.1912-?)
- Un enfant sans vie (1914-1914)
- Il mourut le 28 septembre 1942 au camp d'Auschwitz-Birkenau (Pologne) à l'âge de 54 ans.
Carrière
- Licence en droit
- Doctorat en droit avec une thèse soutenue à Paris en 1912 sur les accidents du travail dans les établissements pénitentiaires.
- Participe à la Grande Guerre.
- Prisonnier de guerre du 29 août 1914 au 10 décembre 1918.
- Agriculteur à Fontenay-lès-Briis (1919-1940).
- Fondateur en 1919 de l'école d'agriculture de Bel-Air à Fontenay-lès-Briis, reconnue d'utilité publique en 1932.
- Maire de Fontenay-lès-Briis (…1924-1931…)
- Scénariste du film (1925)
- Déporté au camp de Drancy (Seine-Saint-Denis) le 23 septembre 1942.
- Mort en déportation au camp d'Auschwitz (aujourd'hui Oswiecim, Pologne)
- Une importante collection de partitions musicales et d'ouvrage musicographiques ayant appartenu à Charles Ferdinand-Dreyfus a été récupérée par la Commission de Récupération artistique entre 1944 et 1949, et depuis intégrée aux collections de la Bibliothèque nationale de France.
Publications
Concernant l'Essonne
- Charles Ferdinand-Dreyfus, "L'Apprentissage agricole", Conférence des sociétés savantes, littéraires et artistiques du département de Seine-et-Oise. Huitième sessions tenue à Versailles les 22, 23 et 24 octobre 1926 sous la présidence de M. Pierre de Nolhac, de l'Académie française. Compte-rendu des travaux, Gap, Louis Jean, 1927, pp. 98-101.
- Charles Ferdinand-Dreyfus, L'Apprentissage agricole (in-8°, 4 p., extrait des Conférence des sociétés savantes de Seine-et-Oise de 1926), Gap, L. Jean, 1928.
- Charles Ferdinand-Dreyfus, La Ferme d'apprentissage agricole de Bel-Air, de 1919 à 1931. Formation technique et morale des apprentis (in-8° oblong, 13,5 cm sur 21), Paris, Lahure, 1945.
- Charles Ferdinand-Dreyfus, Quelques lettres (18 cm, 255 p., portrait, errata), Paris, Lang, Blanchon et Cie, 1950.
Autres publications
- Charles Ferdinand-Dreyfus, Les Accidents du travail dans les établissements pénitentiaires. Thèse pour le doctorat (Université de Paris, faculté de droit) (in-8°, 237 p.), Paris, A. Rousseau, 1912.
Portraits
Documents
- Naissance à Paris 17e arrondissement en 1888 — AD75 V4E/7269.
- Fiche matricule (1909-1931) — AD78 1R/RM 422/matricule 4191.
- Mariage à Paris 17e arrondissement en 1910 — AD75 17M 325.
- Nouvelle de sa survie en 1914 — La Liberté (7 octobre 1914) 2.
- Mort de sa mère en 1917 — Le Figaro 63/34 (3 février 1917) 3 et 63/38 (7 février 1917) 4.
- Divorce en 1919.
- “Mariage dissous par jugement de divorce rendu par le tribunal civil de la Seine le dix huit janvier mil neuf cent dix neuf” (jugement transcrit en marge de l'acte de mariage du 6 juillet 1910).
- Création d'une association en 1919 — Journal officiel de la République française 51/111 (24 avril 1919) 4263.
- Allusion à sa ferme d'apprentissage en 1919 — Auguste Chauvigné, “Apprentissage agricole des Orphelins de la guerre”, Le Tourangeau 30/1785 (19 décembre 1919) 1.
- Visite de son école en 1921 — Le Temps 61/21863 (12 juin 1921) 3.
- Sa maisonnée à Soucy en 1921 — AD91 6M/138.
- Présentation de l'école d'agriculture en 1922 — Gustave Cahen, “L'Apprentissage agricole”, L'Indépendant de Seine-et-Oise 42/2212 (9 septembre 1922) 1.
- Réplique cinglante à André Tardieu en 1924 — L'Œuvre 3144 (10 mai 1924) 6.
- Recommandation d'un administré en 1924 — L'Intransigeant 45/16052 (17 juillet 1924) 6.
- Scénario d'un film en 1925 — Comœdia 19/4484 (26 mars 1925) 3.
- Charles Ferdinand-Dreyfus à la ferme d'apprentissage de Bel-Air vers 1925 — Le Parisien (27 septembre 2019, cliché fourni semble-t-il par Claude Faucheux, secrétaire de l'amicale des anciens et amis de la ferme d'apprentissage agricole de Bel-Air).
- Sa maisonnée à Soucy en 1926 — AD91 6M/138.
- Sa maisonnée à Soucy en 1931 — AD91 6M/138.
- Sa maisonnée à Soucy en 1936 — AD91 6M/138.
- Bulletin municipal officiel de la Ville de Paris 55/19 (14 janvier 1936) 449-450.
- Bulletin municipal officiel de la Ville de Paris 57/301 (29 décembre 1938) 4773 et 4782.
- Décès à Auschwitz en 1942 — Journal officiel de la République française 48 (25 février 1996).
- Extrait
- Arrêté du 5 décembre 1995 portant apposition de la mention “Mort en déportation” sur les actes de décès
- Par arrêté du ministre délégué aux anciens combattants et victimes de guerre en date du 5 décembre 1995, il est décidé d'apposer la mention “Mort en déportation” sur les actes de décès de: (…)
- Ferdinand-Dreyfus (Jacques, Isidore), né le 8 décembre 1884 à Paris (17e) (Seine), décédé le 5 août 1943 à Auschwitz (Pologne).
- Ferdinand-Dreyfus (Charles), né le 14 janvier 1888 à Paris (17e) (Seine), décédé le 28 septembre 1942 à Auschwitz (Pologne). (…)
Archives
Archives de l'Essonne
- 3Q7/167/n°21 (Enregistrement de Limours-en-Hurepoix) — Déclaration de succession de Charles-Ferdinand Dreyfus, agriculteur demeurant à Soucy, commune de Fontenay-lès-Briis, divorcé de Germaine-Edwige-Anna Behrendt, lui décédé à Auschwitz (Pologne) le 28 septembre 1942, dont le frère Jacques-Isidore-Ferdinand Dreyfus, directeur général de la Caisse de Garantie des Assurances Sociales, demeurant à Paris, est décédé mort pour la France audit Auschwitz le 5 août 1943 (17 mars 1949).
Bibliographie
Gustave Cahen (1922)
- Gustave Cahen, “L'Apprentissage agricole”, L'Indépendant de Seine-et-Oise 42/2212 (9 septembre 1922) 1.
- Extrait
- Le 12 (le ce mois s'ouvrira, à Versailles, l'Exposition des Travaux d'Apprentissage des Pupilles de la Nation de Seine-et-Oise. Le 31 décembre 1921, ils étaient au nombre de 12.436.
- Sur ces 12.436 pupilles, il y eu a, cette année, 882 qui ont 14 ans, 1.005 qui ont 13 ans, 1.120 qui ont 12 ans, en tout 3.007.
- Sur ces 3.007 Pupilles, M. Charles Ferdinand-Dreyfus demande trente garçons pour sa ferme d’apprentissage agricole de Bel-Air, par Briis-sous-Forges.
- Propriétaire d'une ferme de 50 hectares, il l'a louée à une Association moyennant un loyer de un franc. Comme administrateur délégué de cette Association, il a, en 1920 et en 1921, versé dans la caisse sociale, sous forme de dons manuels, des sommes dont nous n'indiquerons pas le montant pour ne pas le désobliger. Le voilà maintenant amené à publier une brochure ornée d'images et à répandre dans tous les offices et dans tous les dispensaires de la région, pour obtenir trente enfants dont l'œuvre qu'il dirige puisse, en trois ans, faire de bons et braves cultivateurs, conscients de leur devoir professionnel, moral et social, et susceptibles, par leur travail rationnel et régulier, d’apporter leur contribution au relèvement et à la prospérité du pays.
- La tâche, est, paraît-il, ardue. Car au mois de Juillet 1922, l'effectif de la Ferme n’était que de 28 apprentis, et sur ces 28 apprentis, il n’y en avait que 22 qui fussent des Pupilles de la Nation.
- Il faut donc recourir à la publicité.
- Voici ce que dit M. Charles Ferdinand-Dreyfus dans sa brochure:
- Il explique d'abord qu'il a voulu, au retour de la guerre, alors que tous les cultivateurs se plaignaient de ne plus trouver de bons ouvriers agricoles, créer une pépinière qui. produirait ce personnel si difficile à recruter.
- Pour atteindre ce but, il a voulu donner à l'apprentissage une durée assez longue afin que les aptitudes de l'enfant puissent s'affiner et qu'il puisse, à la fin de son apprentissage, choisir la branche du travail agricole qui lui conviendrait le mieux.
- L'établissement est absolument gratuit.
- Il contient trente places. Il ne reçoit que des internes. Les enfants ne reçoivent pas de salaire. Mais ils touchent, à la fin de leur apprentissage, un pécule constitué au moyen d'un prélèvement sur le montant de la vente des produits de la Ferme. Pendant la durée du séjour de l'enfant, l'Œuvre pourvoit à tous les frais de logement, d'alimentation, d'habillement, d'entretien, d'instruction.
- L'année débute le 1er Octobre.
- Les enfants sont admis à l'âge de 13 ou 14 ans s'ils ont passé leur certificat d'études primaires. Nous n'entrerons pas dans le détail du régime intérieur. Disons seulement que l'établissement est une ferme d'apprentissage agricole, qu'il n'est donc ni un sanatorium, ni une maison de correction. Il s'agit de mettre entre les mains des enfants le plus stable et le plus sain des métiers.
- Les Pupilles de la Nation sont admis de préférence.
- Nous ne parlerons pas de l'aménagement de la ferme. M. Charles Ferdinand-Dreyfus a pris le soin d'intercaler, dans le texte de sa brochure, trente-huit photographies, qui montrent les bâtiments, le dortoir, la cuisine, le réfectoire, etc. On y voit les enfants détruire les œufs de bourdon, ramer les haricots grimpants, jouguer les bœufs, alimenter et traire les vaches, nourrir les agneaux au biberon, écrémer le lait, tondre les brebis, labourer, rentrer les foins, faire les chemins, moissonner, battre les récoltes, tronçonner les arbres abattus, etc.
- La culture consiste en avoine, fourrages artificiels, blé, seigle, escourgeon, betteraves fourragères, rutabagas, pommes de terre, carottes, haricots, soja.
- Cinq chevaux, quatre bœufs de trait, neuf vaches laitières, six génisses, un taureau, vingt-quatre brebis, des porcs, des lapins, des poules, constituent le cheptel.
- Le travail est réparti entre les enfants, de manière à le rendre attrayant par la diversité.
- Voici le programme d'une journée moyenne de printemps ou d'automne:
- À 5 h. 50, réveil et lever de l'équipe chargée de traire les vaches et de donner à manger aux bêtes de trait. Chaque enfant passe à tour de rôle, tous les cinq jours, à ce travail. Les équipes étant de cinq ou six enfants chacun, au lever, ne trait qu'une vache, deux au plus par exception.
- À 6 h. 20, réveil des autres enfants. Chacun fait son lit, toilette au lavabo, torse nu et eau froide, en toute saison.
- À 7 heures, petit déjeûner: un demi-litre de lait par enfant, avec un farineux (tapioca, crème de riz, etc.; le jeudi, chocolat au lait; le dimanche, café au lait, avec pain à volonté). Tartine de fromage ou de beurre destinée à être mangée au milieu de la matinée.
- Travail de 7 h. 1/4 à 11 h. 3/4, plus ou moins coupé de haltes.
- À midi, déjeuner: soupe, viande, deux légumes, dessert. Une fois par semaine, le poisson remplace la viande. Les œufs remplacent un légume, ou le dessert.
- Départ pour le travail variant de 13 heures en hiver, à 15 heures en été; retour des champs, variant de 16 heures en hiver, à 20 heures en été.
- Vers 16 ou 17 heures, goûter: pain, chocolat en tablettes; en été, boisson (coco).
- Entre 18 et 19 heures, traite des vaches.
- Selon la saison, dîner un quart d'heure après le retour des champs en été. En hiver, enseignement post-scolaire pendant une heure à une heure trois quarts avant le dîner.
- Menu du dîner: soupe, farineux, dessert.
- Ce menu est fréquemment augmenté pendant les périodes des durs travaux. La ration de viande quotidienne est de 100 grammes environ. Les enfants ont pain et légumes à volonté. Leur boisson est du cidre coupé d'eau.
- Les enfants ont tout au moins huit heures de sommeil. Ils dorment la fenêtre ouverte.
- Pour les soins de propreté, douches froides à volonté. Obligation d'en prendre, en été, chaque soir, au retour du travail, et, en hiver, de prendre au moins une douche chaude par semaine.
- Pendant les heures de récréation qui suivent les repas, les enfants disposent de livres, de jeux soit de plein air, soit d'intérieur.
- L'enfant écrit à qui il veut, autant qu'il veut. Pas de lecture obligatoire, pas de jeu obligatoire.
- Les travaux quotidiens de ménage ou d'épluchage sont exécutés par des domestiques salariées, avec l'aide de la directrice. Les bonnes balayent tous les jours les dortoirs.
- Les enfants les encaustiquent à tour de rôle une fois par semaine. Ils entretiennent les étables, les écuries, les douches et les w.-c. Ils apprennent tous à repriser leurs chaussettes.
- Le dimanche, ils ont toute liberté d'action dans le parc de Soucy (37 hectares): foot-ball, courses, saut, jeux de balle, pêche à la ligne, billard, jeux de dames, dominos, manille, mécano.
- En hiver, projections, séances de cinéma, livres, revues.
- Les récompenses consistent en promenades, visites aux Expositions agricoles, voyages, permissions en famille, vacances.
- Les punitions consistent en travaux supplémentaires, privation de jeux.
- Telle est la vie que mènent les enfants.
- Qu'apprennent-ils?
- Ils choisiront plus tard leur spécialité. Mais ils apprendront à accomplir les travaux suivants:
- Soigner et conduire les chevaux; soigner et conduire les bœufs; soigner et traire les vaches; faire du beurre et du fromage, engraisser un veau et un cochon; élever poulets et lapins; soigner les brebis et les agneaux; tondre la laine; faire une castration facile; labourer un brabant, se servir de la canadienne, de la herse, de la herse à prairie, du rouleau, du distributeur d'engrais, du semoir à grains; soigner le fumier; semer à la main, engrais ou semences; mener la boue à cheval; le butoir à pommes de terre; le semoir à haricots; faucher à la faux; mener la faucheuse à foin; la rateleuse, la moissonneuse-lieuse; faire des voitures de foin ou de paille; faire des meules; se servir de la batteuse; lier les gerbes; user du tarare; du trieur; du coupe-racines; de l'aplatisseur à grains; de tous les outils de jardin; démonter, entretenir, remonter et régler les instruments employés, faire les manches d’outils, affiler les diverses scies; faire de la menuiserie, du charronnage, de la forge, de la vannerie, fabriquer du cidre, faire l’ouvrage de bûcheron, choisir les arbres à abattre, les abattre, les débiter, distinguer de quel bois on fera du plancher, des pieux, des manches d'outils, des échelles, une planche de tombereau, un côté de brouette, des claies, un pèse-veau, une vêleuse, ou un broyeur de pommes de terre, savoir quel bois ne sera bon qu'à brûler.
- Les apprentis pratiquent tour à tour, pour les besoins de l'établissement, la culture potagère, l'arboriculture fruitière et un peu d'horticulture. Ceux qui aiment les fleurs, choisissent les variétés dont ils ornent le jardin. Ils soignent tous le rucher, nettoient les ruches à cadre, et récoltent le miel à l'aide de l'extracteur centrifuge. Ils apprennent à mener et à entretenir le tracteur; à tenir la comptabilité de la laiterie, la comptabilité générale de l'exploitation et à faire la correspondance. Ils apprennent, en un mot, à se faire apprécier par leur futur patron, et à se tirer d'affaire par leurs propres moyens, le jour où ils seront leurs maîtres.
- Enfin, les enfants reçoivent l'enseignement post-scolaire qui convient à leurs facultés et à leur degré d'instruction.
- Ajoutons que l'Association se charge, avec le consentement de la famille, de placer elle-même ses apprentis, quand ceux-ci quittent la ferme.
- La tâche à laquelle elle se consacre, consiste à donner, tous les ans au pays, dix travailleurs agricoles, aptes à devenir des cultivateurs d’élite.
- Tel est le but que poursuit l'école gratuite d'apprentissage agricole de Bel-Air.
- L’Association a constitué un Comité d'honneur, dont font partie toutes les personnes ou collectivités qui effectuent les versements ci-après:
- 1° Mille francs une fois versés, donnent droit au titre de membre perpétuel;
- 2° Cotisation annuelle minimum de cent francs, donnant droit au titre de membre bienfaiteur;
- 3° Cotisation annuelle minimum de dix francs, donnant droit au titre de membre adhérent.
- Les membres du Comité d'honneur sont convoqués, tous les ans, en Assemblée générale, et sont mis au courant de la marche de l'Association, des moyens mis en œuvre et des résultats obtenus.
- En 1920, les cotisations des membres du Comité d'honneur se sont élevées à 3.975 francs. En 1921, elles se sont élevées à 13.285 francs. Il est à souhaiter que cet appui moral et financier se continue et se développe de plus en plus.
- Il le faut d'autant plus, que le Conseil général de Seine-et-Oise, qui avait accordé à l'Œuvre une subvention de 1.000 francs en 1920, a réduit cette subvention à 500 francs en 1921.
- L'Office National des Pupilles de la Nation avait accordé, en 1920, une subvention de 10.000 francs à l'Association pour l'achat d'un tracteur, et cette somme avait été imprudemment portée à l'actif du bilan de l'Association.
- Mais M. Lebureau veillait et au bilan, de 1921, dans la colonne du passif, on lit cette mention:
- Recette défaillante, inscrite au budget de 1920, et impossible à encaisser: 10.000 fr.
- En revanche, nous continuerons à entendre des discours pathétiques sur la nécessité de développer l'agriculture et de favoriser le retour à la terre.
- La brochure de M. Charles Ferdinand-Dreyfus dit quelque part:
- “Nous voulons faire de nos enfants, non seulement déplions cultivateurs qui comprennent pourquoi il faut façonner la terre, mais aussi de bons citoyens, lucides, se méfiant des rhéteurs”.
- C'est qu'en effet, il sait mieux que personne, que ce n'est pas avec des phrases qu'on forme des cultivateurs d'élite.
- Mais en parlant ainsi, il est loin de montrer le moindre découragement. Il constate, au contraire, avec satisfaction, que si, au cours des deux premières années, l'Association qu'il administre, n'était parvenue à toucher qu'un nombre de subventions d'apprentissage minime, par contre, cette année, la plupart des Offices départementaux des Pupilles de la Nation lui ont versé des subventions d'apprentissage variant de 0 fr. 66 à 4 francs par jour, et par Pupille.
- De plus, vingt-sept Conseils municipaux du département de Seine-et-Oise se sont déjà fait inscrire au Comité d'honneur, soit comme membres bienfaiteurs, soit comme membres adhérents.
- Si en publiant ces divers renseignements, nous parvenons à aider la Ferme d'apprentissage agricole de Bel-Air, à compléter son effectif de trente apprentis pour le premier octobre prochain, nous serons heureux d'avoir apporté un faible concours à une œuvre qui honore le nom de notre regretté Sénateur, Ferdinand-Dreyfus.
- Gustave Cahen.
Comœdia (1925)
- Anonyme, “Le cinéma agricole. 'L'Enfance à la terre'”, Comœdia 19/4484 (26 mars 1925) 3
- Extrait
- Cinémas. — Le cinéma agricole. — “L'Enfance à la terre”
- On a présenté avant-hier soir jeudi à la salle des Horticulteurs, un film d'orientation professionnelle, édité par la commission du cinéma agricole du ministère de l'Agriculture.
- M. Queuille, ministre de l'Agriculture, présidait cette manifestation, assisté de M. A. Massé, ancien ministre, président de la commission du cinéma agricole, et de MM. Vialla, membre de l'Institut; Guesnier et Provost-Dumachis, sénateurs.
- M. Massé en prenant la parole remercie le ministre de l'intérêt qu'il a toujours témoigné à l'œuvre du cinéma agricole. Il retrace à grands traits l'histoire de cette œuvre qui ne date que de deux ans et indique ses directives et son programme.
- Le film L'Enfance à la terre diffère de ceux jusqu'ici adoptés en ce qu'il est destiné beaucoup plus à la propagande qu'à l'enseignement proprement dit.
- M. Massé expose les graves conséquences que peut avoir l'exode de plus en plus grand des populations rurales vers les villes: impossibilité pour l'agriculteur de se procurer la main-d'œuvre nécessaire, terre restant en friche, ou mise en prairies et soustraite par suite à la culture du blé.
- La France avant la guerre produisait, à peu de chose près, la quantité de froment dont elle avait besoin. La production aujourd'hui est déficitaire. Elle est obligée d'importer chaque année de 12 à 15 millions de quintaux représentant une dépense minimum de plus d'un milliard et demi susceptible d'augmenter lorsque le change nous est défavorable et qui en tout cas ne peut que déprécier notre franc.
- On voit par là toute l'importance du problème de la main-d'œuvre agricole. La commission du cinéma a pensé utile d'entreprendre une propagande pour ramener à la terre des forces et des énergies nouvelles.
- Parmi les fils ou petits-fils d'anciens ouvriers agricoles occupés dans les villes, il est possible d'en trouver chez lesquels on réveillera le sentiment si profond d'amour de la terre qu'ont connu leurs pères. Pour cela, il suffit d'un hasard. Mais on aurait tort de ne compter que sur lui pour cela. C'est pourquoi la commission du cinéma a demandé à M. Charles-Ferdinand Dreyfus qui, en véritable apôtre se consacre à l'œuvre d'éducation professionnelle agricole, de vouloir bien établir le scénario d'un film qui pourrait être projeté dans les écoles et dans les villes pour essayer d'éveiller la vocation agricole chez ceux qui ne connaissent point les travaux de la terre.
- M. Charles-Ferdinand Dreyfus et M. Jean Benoit-Lévy ont réalisé ce projet. Ils ont pris pour cadre la ferme de Bel-Air où M. Dreyfus donne l'enseignement agricole pratique à une trentaine d'enfants venus de tous les milieux. Ce qui caractérise ce film, c'est sa très grande sincérité. Rien n'y est truqué. On y assiste à tous les travaux pratiqués à Bel-Air dans les conditions mêmes où ils le sont normalement. M. Dreyfus reçoit des enfants dès l'âge de 13 ans. Son premier soin est de faire naître, puis de développer en eux l'esprit d'initiative, le sentiment de la responsabilité professionnelle.
- Dès leur arrivée, les enfants, sous la direction de M. Dreyfus et d'un chef de culture se livrent seuls ou avec la collaboration de leurs camarades plus âgés, ayant déjà quelque expérience, à tous les travaux de la ferme. Ils attellent et conduisent bœufs et chevaux. Ils préparent le sol, les engrais, les semences. Au moment de la moisson la conduite des machines leur est confiée. Ainsi pendant les trois années qu'ils passent à Bel-Air, ils s'initient à tous les travaux des champs.
- Lorsqu'ils quittent le centre d'apprentissage, ils trouvent aisément à se placer. Le salaire qu'ils reçoivent est plus élevé que celui de la plupart des ouvriers qui n'ont pas reçu le même enseignement. Ce salaire leur permettra avec de la conduite et du travail de faire des économies, et au bout de dix à douze ans de s'installer à leur propre compte en achetant un lopin de terre qu'ils pourront agrandir dans la suite.
- M. Massé, en terminant, appelle l'attention des spectateurs sur les grands services qu'ils peuvent rendre à l'œuvre en deyenant ses collaborateurs bénévoles. Il leur suffira de se rendre compte des milieux dans lesquels ce film pourrait être tourné avec fruit et d'indiquer aux personnes susceptibles de le présenter qu'elles peuvent se le procurer gratuitement pour un temps déterminé en s'adressant à la Cinémathèque centrale du ministère de l'Agriculture qui est annexée au musée pédagogique.
- Un nombreux auditoire applaudit l'orateur qui, en terminant, rendit hommage à l'apostolat de M. Charles-Ferdinand Dreyfus.
- Le film L'Enfance à la terre réalisé par Jean Benoit-Lévy, et cinégraphié par Ed. Floury, fut ensuite projeté. Le public y prit grand intérêt.
- Les nombreuses demandes de la part d'éducateurs présents dans la salle, ont prouvé qu'il avait pleinement atteint son but.
Pauline Darvey (2019)
- Pauline Darvey, "Essonne: il y a 100 ans, il créait l'une des premières fermes d'apprentissage de France", Le Parisien (27 septembre 2019)
- Extrait
- Charles Ferdinand-Dreyfus a accueilli et formé des centaines de pupilles de la Nation et d'enfants défavorisés à la ferme de Bel-Air, à Fontenay-les-Briis. Ce dimanche, une fête est organisée pour le centenaire de la création de ce lieu.
- Sur le cliché en noir et blanc, Charles Ferdinand-Dreyfus, le fondateur de la ferme d'apprentissage, se tient droit, légèrement à l'écart du groupe. À sa gauche, une femme, certainement la cuisinière, une dizaine d'enfants et deux vaches entourent un tracteur. “Cette photo doit dater de 1925”, estime Claude Faucheux, secrétaire de l'amicale des anciens et amis de la ferme d'apprentissage agricole de Bel-Air, qui organise ce dimanche une fête pour le centenaire de ce lieu, à Fontenay-les-Briis. “Vous voyez les pavés et le corps de ferme sont d'origine”, assure ce retraité, en montrant la cour et la vaste bâtisse qui abrite désormais un restaurant, situées le long de la rue Charles Ferdinand-Dreyfus. “Elle a été baptisée comme ça en hommage à cet homme”, poursuit cet ancien cadre dans l'aéronautique.
- “Donner un sens à sa vie”.
- Il y a tout juste 100 ans, Charles Ferdinand-Dreyfus créait l'une des toutes premières fermes d'apprentissage de France. Pour retracer cette histoire, il faut remonter encore un peu plus loin dans le temps, en 1905. Cette année-là, le père de Charles, Ferdinand Ferdinand-Dreyfus, sénateur de Seine-et-Oise — qui avait accolé son prénom à son nom de famille pour ne pas être associé à l'affaire Dreyfus — achète le domaine de Soucy, qui comprend sur une centaine d'hectares un château, une ferme, des dépendances et des terres. En 1914, Charles a 26 ans et un doctorat de droit en poche, quand il est appelé pour aller servir la France. “Mais il n'a pas eu de chance, raconte Claude Faucheux, arbre généalogique à l'appui. Trois semaines après sa mobilisation, il est blessé puis fait prisonnier par les Allemands jusqu'à la fin de la guerre.” Il ne rentre d'Allemagne qu'en décembre 1918. Entre-temps, le sort s'est acharné sur le jeune soldat qui a perdu ses deux parents et qui a été quitté par sa femme.“ Il avait besoin de donner un sens à sa vie, analyse Claude Faucheux. Et il savait qu'il allait hériter de ce domaine. “C'est finalement du hasard d'une rencontre que naîtra l'idée de cette ferme d'apprentissage. En prison, Charles se lie d'amitié avec Paul Marsais, un ingénieur agronome. “À la fin de la guerre, il y avait beaucoup d'orphelins, reprend le secrétaire de l'amicale. Et il y avait aussi besoin de nourrir la population.”
- En 1919, la ferme de Bel-Air est née. Jusqu'en 1958, environ 350 enfants âgés de 13 ans ou plus y sont accueillis et formés entièrement gratuitement. Tous sont pupilles de la Nation ou issus de milieux défavorisés. La vente des produits de la ferme, des dons et la fortune personnelle de “cet homme simple” permettent de nourrir et de loger les enfants dans les dortoirs de la ferme. “Charles les appelait 'ses fils', rapporte encore le retraité. Il a tout donné pour eux.” “Je me souviens des anciens de la ferme qui venaient manger chaque année ici en son souvenir, raconte Yves Noël, entré comme stagiaire à la ferme transformée en centre de formation pour adultes (CFA) en 1974 puis embauché comme moniteur. Ils avaient tous une grande affection pour lui.” C'est une autre guerre qui scellera définitivement le destin de celui qui a également été maire de la commune. En 1942, il est convoqué à Paris, puis envoyé à Drancy, à Pithiviers et déporté à Auschwitz, où il est tué quelques jours plus tard.
- Un ancien élève, qui l'assistait dans la gestion de la ferme, reprend sa direction jusqu'en 1958. La ferme pédagogique est contrainte de fermer cette année-là pour des raisons économiques. La chambre d'agriculture reprend alors le site, qui reste propriété de la fondation Charles Ferdinand-Dreyfus et la transforme en centre de formation pour adultes. De 1990 à 2004, la ferme devient un lieu de formation en cuisine, hôtellerie, restauration, ventes, espaces verts… Les élèves ont depuis laissé la place à des commerçants. Salon de coiffure, restaurant, boulangerie, primeur occupent les différents bâtiments. Mais l'histoire de Charles et de “ses fils” imprègne, elle, toujours les lieux.
Dictyographie
- Alain Girod, "Charles Ferdinand-Dreyfus", Généanet, en ligne en 2024.
- Robert Cabane, "Charles Ferdinand Dreyfus", Généanet, en ligne en 2024.
- “Charles Ferdinand-Dreyfus s'est essentiellement occupé du domaine de Soucy (Fontenay-lès-Briis), où il créa une ferme-école. Il habitait dans les “communs” de l'ancien château de Soucy et y recevait volontiers sa famille et ses amis.”
hn/ch.ferdinanddreyfus.txt · Dernière modification : de bg